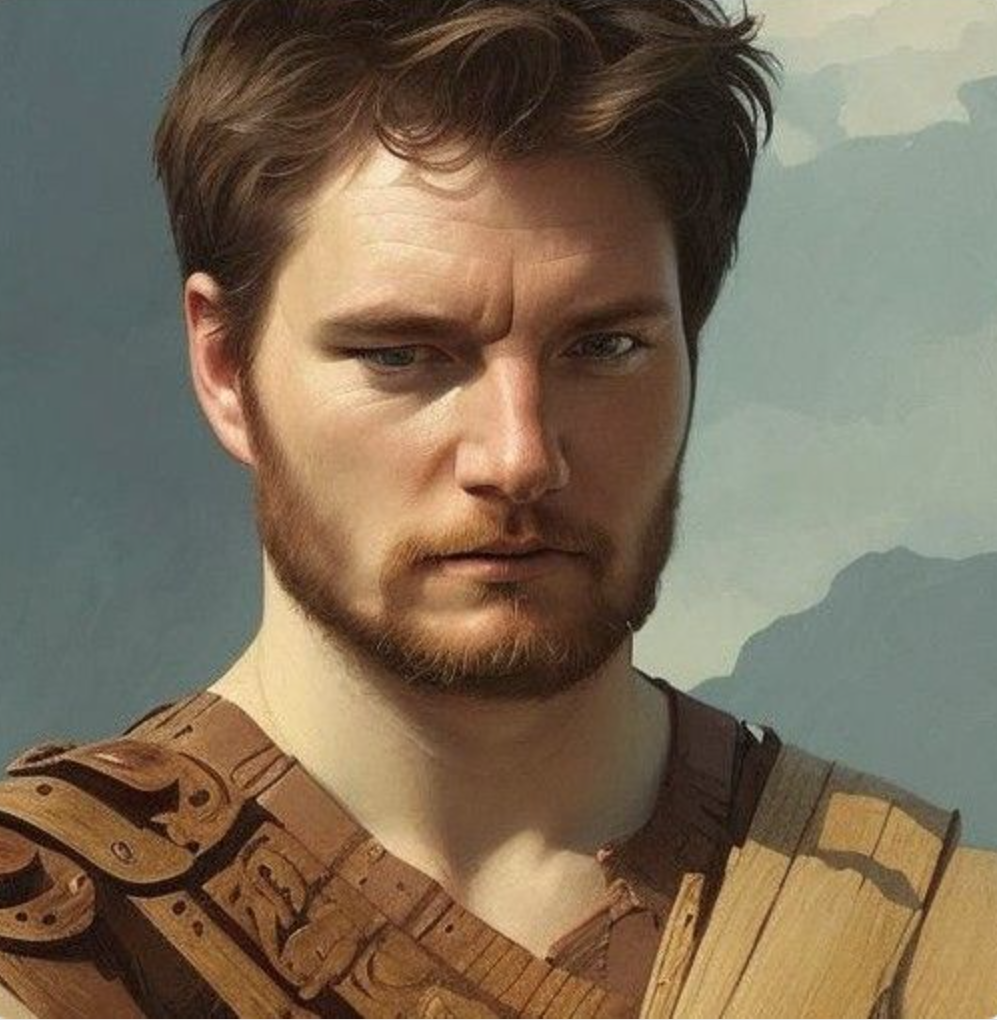
David L'Epée
11 novembre 2022 • 13 minutes de lecture
Va te faire culbuter dans la préhistoire !
Je suis sûr que vous pensez à la même chose que moi, là, maintenant. D’ailleurs vous êtes comme tout le monde : vous ne pensez qu’à ça. Deux fois par mois je débroussaille avec vous la jungle luxuriante et luxurieuse de l’amour et de l’éros.


Si je vous dis culbute et préhistoire, vous pensez à quoi ? Pour ma part je pense à une des premières scènes de La Guerre du feu de Jean-Jacques Annaud (1981) dans laquelle le très lointain ancêtre de grand-papa surprend, la croupe à l’air au bord de la rivière, la très lointaine aïeule de grand-maman, et la saillit sans autre forme de procès tandis que les autres femelles du clan continuent, imperturbablement, à laver des fruits dans l’eau courante. Il faudra encore attendre quelques générations avant la consent theory et les contrats de culbutage dûment signés devant notaire. Je devais avoir une douzaine d’années quand j’ai vu ce film chez un copain (son père nous avait laissé cette VHS pour avoir deux heures de paix et de silence) et je crois bien que c’est la toute première levrette à laquelle il m’ait été donné d’assister. Et ça c’est quelque chose qui s’oublie difficilement.
On peut rire bien sûr de la sexualité des grands singes et des bonobos mais dans le cas de ces primates-là l’affaire est un peu différente car il s’agit tout de même de nos lointains prédécesseurs et il se trouve que nous sommes les héritiers de 200.000 générations humaines et pré-humaines depuis le temps des australopithèques. Et ça, forcément, ça laisse des traces, un atavisme, quelque chose qui demeure en nous y compris dans le domaine des choses du sexe.
Les quadrupèdes se montent dessus, les bipèdes font l’amour
Pendant des millénaires et des millénaires la sexualité de nos ancêtres relevait tout au plus de l’éthologie animale, il n’y avait pas grand-chose à en dire et il était encore difficile d’y voir ce qui liait leurs pratiques aux nôtres. Et soudain, paf ! petite révolution dans l’éros : on passe à la bipédie. Rien de tel pour varier les positions du Kâma-Sûtra qu’un peu d’évolution darwinienne ! On parle dans ce cas-là d’une modification d’ordre orthostatique : l’être humain s’est progressivement relevé jusqu’à avoir le dos droit et pouvoir marcher en s’équilibrant uniquement sur ses deux pattes arrière.

Buster Keaton en homme préhistorique dans Les Trois Âges (1923). Une certaine vision du couple.
Chez la femme cette nouvelle position a nécessité un rééquilibrage général du corps : elle a amené une cambrure plus marquée et un relèvement des seins, ce qui – vous en conviendrez chers lecteurs – est une configuration qui aujourd’hui encore (et pour longtemps j’espère) parle directement à nos sens. Comme l’explique l’anthropologue Vincent Dussol, « le développement important et spécifique chez l’espèce humaine de la poitrine est certainement l’une des toutes premières conséquences mécaniques et gravitationnelles de la station debout » (La Domination féminine. Réflexions sur les rapports entre les sexes, Jean-Claude Gawsewitch, 2011, p.83-84). Selon lui, c’est la fonction érotique elle-même qui est née avec le passage à la position bipède et elle ne doit pas être comprise comme une détermination de l’hominisation mais bien comme une de ses conséquences. Elle marque avant tout une rupture avec la sexualité animale.
Lorsqu’elle marchait encore à quatre pattes, la femme était facilement accessible à tous les hommes de par l’exposition vulvaire induite par sa posture. Il suffit d’observer les chats et les chiens pour voir comment les choses se passent en pareille configuration. La bipédie, mettant fin à cette accessibilité sexuelle des femelles, a poussé les mâles, une fois leur première frustration passée, à développer par compensation leur imagination et leurs fantasmes. Cette même bipédie permettant une meilleure dissimulation physique des organes sexuels, elle a entrainé deux notions proprement humaines inconnues jusqu’alors par nos ancêtres velus : la suggestion et la séduction. Ainsi naquit l’érotisme.
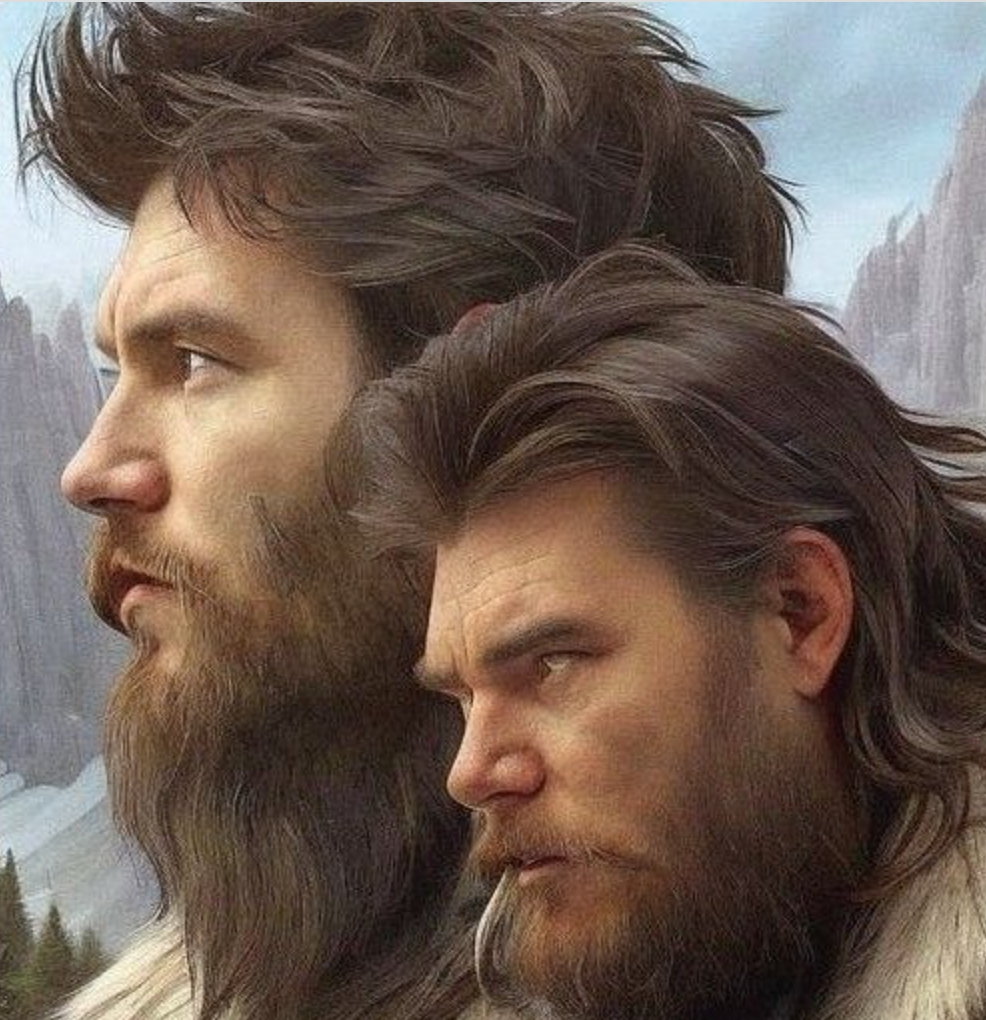
L'auteur de cet article en version préhistorique. "Au fil de L'Epée", c'est avant tout de l'immersion et de l'ethnologie participante !
La femme bipède est une bonne mère, l’homme bipède est un violeur
Selon la féministe russe Alexandra Kollontaï, c’est la femme qui aurait été la première à adopter la position bipède. On se demande d’où elle tient cette information et on essaie d’imaginer, pendant plusieurs générations, à quoi pourraient ressembler des couples constitués d’une femme debout et d’un homme à quatre pattes… Dans une conférence intitulée La situation de la femme dans le communisme primitif, elle déclare la chose suivante : « La station verticale si caractéristique de l’être humain a été essentiellement une conquête de la femme. Dans les situations où notre ancêtre à quatre pattes devait se défendre contre les attaques ennemies, elle apprit à se protéger d’un seul bras, tandis que de l’autre elle tenait fermement son petit contre elle, qui s’agrippait à son cou. Elle ne put cependant réaliser cette prouesse qu’en se redressant à demi, ce qui développa par ailleurs la masse de son cerveau. Les femmes payèrent chèrement cette évolution, car le corps féminin n’était pas fait pour la station verticale. Chez nos cousins à quatre pattes, les singes, les douleurs de l’enfantement demeurent totalement inconnues. » (Conférences sur la libération des femmes, Éditions de la Brèche, 1978, p.17-18) A défaut d’être vérifiable il faut reconnaître que c’est assez malin. Si non e vero e ben trovato.
Ce qui est certain en tout cas, c’est que le passage au bipédisme chez la femme a entrainé un rétrécissement du bassin qui, s’il pourrait effectivement expliquer les douleurs de l’accouchement, a aussi contribué à réduire le temps de la gestation, multipliant de ce fait les naissances prématurées et nécessitant donc des soins accrus pour assurer la survie de l’enfant. D’où l’intérêt de former des couples stables, impératif qui lui aussi constitue une révolution dans l’éros – et prépare la voie, bien plus tard, à l’institution du mariage.

La préhistoire vue par Jul dans son album Autorisation de découverte, premier tome de sa série Silex and the City
Et le passage au bipédisme chez l’homme, alors, qu’a-t-il entrainé comme conséquence ? Rien de bien joli, à en croire la psychanalyste Hélène Deutsch qui, dans le second tome de sa Psychologie des femmes, explique : « Nous pensons que grâce à l’acquisition de la posture verticale et à la formation de puissants appendices préhensibles, le mâle a pu se libérer du rythme féminin et prendre sexuellement la femme sans qu’elle y consentît. On peut dire sans exagération que, de tous les êtres vivants, l’homme seul est capable d’effectuer le viol dans l’acception totale du terme, c’est-à-dire la possession de la femme contre sa volonté. » Ça pourrait expliquer en effet la fameuse scène de La Guerre du feu au bord de la rivière mais quant à savoir si le viol est inexistant chez les quadrupèdes il faudrait s’adresser à un zoologue car j’avoue que je n’en ai pas la moindre idée.
De la levrette au missionnaire : un petit coup de rein pour l’homme, un grand pas pour l’éros
Le film d’Annaud, je m’en souviens, proposait plus tard dans le métrage une scène qu’on pourrait qualifier d’érotique puisqu’elle montrait la découverte, par une femme et un homme préhistoriques, de la position du missionnaire. Contrastant avec la scène de la rivière, elle laissait entendre qu’une véritable tendresse était possible à partir du moment où les deux partenaires se faisaient face et pouvaient se regarder l’un l’autre pendant l’acte. Tout laisse à penser en effet que la découverte de cette nouvelle position a permis non seulement de poser la question du consentement par l’irruption du contact visuel mais aussi de favoriser une plus grande participation active de la femme tout en lui permettant une stimulation clitoridienne qui n’était pas possible avec la levrette. Dans le cadre de certaines limites bien sûr, comme l’explique le sexologue Gérard Zwang dans le tome 2 de sa somme La Fonction érotique : « Les positions métaphysiques “correctes” impliquent la situation inférieure de la femme. Le rituel copulatoire de la plupart des primitifs obéit à ce schéma, et exclut toute fantaisie buccale ou manuelle. » (Robert Laffont, 1972, p.238)
Évitons toutefois les raccourcis simplistes : ce serait aller un peu vite en besogne de conclure que la transition de la levrette au missionnaire coïncide avec une transition de la pulsion animale à l’amour avec un grand A. « L’amour-fou n’existe pas chez le primitif, comme le rappelle le philosophe Michel Clouscard dans son Traité de l’amour-fou. On n’a jamais trouvé, chez les Bororos, un amant caché dans le placard. Pour la bonne raison qu’il n’y a pas de placard (infrastructure) ni d’amant (superstructure). Il n’y a qu’un implacable jeu de totems, de tabous, de système de la parenté, tout ce qui est nécessaire au surgissement de la première existence sociale, laquelle n’est alors possible que par une mécanisation totale qui ne prévoit aucune marginalité, aucune contestation, aucun désordre. Il n’y a pas de société civile, d’emploi du temps pour le romanesque, le romantique, l’amour-fou. » (Kontre-Kulture, 2013, p.270) Pour l’amour courtois, la vague des passions nervalienne et le vaudeville, il faudra encore attendre un peu. L’archéologue Jean Courtin considère qu’on ne peut parler de sentiment amoureux qu’à partir que -100.000 av. J-C environ, à l’ère de l’homme de Cro-Magnon, sentiment dont l’apparition coïnciderait avec le développement dans les sociétés préhistoriques du goût de l’esthétique et de l’ornementation.

N'en déplaise à cette scène de La Guerre du feu, le sexe oral ne semble pas avoir été prisé par nos ancêtres préhistoriques
Quand les femmes préhistoriques faisaient des bébés toutes seules…
La sexualité de nos ancêtres aux mâchoires prognathes, quoique répondant à une pulsion physiologique, est avant tout procréative. Pourtant, il leur a fallu pas mal de temps pour réaliser qu’il existait une corrélation directe entre la culbute et la grossesse de madame. L’humanité a connu une longue période de croyance en la parthénogénèse avant de comprendre les mécanismes réels de la procréation. Cette mécompréhension du processus d’enfantement par les premiers hominidés bipèdes n’est sans doute pas sans rapport, là encore, avec la dissimulation des organes sexuels consécutive au passage à la station debout. Comme l’explique l’essayiste Olivia Gazalé dans son livre Le Mythe de la virilité, « la femme incarne à elle seule la fertilité et la force créatrice de la nature. Quant à l’homme, sa paternité est exclusivement symbolique, et ritualisée à la façon d’une adoption. » (Robert Laffont, 2017, p.36)
Parlant du rapport de causalité entre le coït et la reproduction, Vincent Dussol écrit : « Ce processus, intelligible chez les mammifères, échappait totalement à l’entendement dans l’espèce humaine. La femelle, après avoir dissimulé son sexe, ses prédispositions périodiques, à l’égard du mâle et de l’accouplement, a occulté du même coup le mécanisme de la reproduction. La venue d’un enfant n’entrait dans aucune interprétation concrète et rationnelle. Dans l’inconscient collectif de ces peuples primitifs, la femme était capable de procréer toute seule. » (p.156) Il ajoute que chez les peuples premiers on admet d’ailleurs plus facilement le rôle de l’homme dans la génération de la mandragore (la fameuse éjaculation du pendu – je vous laisse faire vos recherches) que dans la reproduction humaine…
Cette vision de la femme comme source unique et autonome de la vie expliquerait, selon certaines anthropologues, l’existence des premières formes de croyances religieuses, les religions dominantes ayant souvent pris des formes matricielles, dans la vénération des déesses-mères. Mais compte tenu de la rareté des traces attestant de cette période on oscille toujours, dans cette matière, entre les hypothèses sérieuses et les interprétations idéologiquement orientées. Dans son livre Le Langage de la déesse (1994) l’archéologue lituano-américaine Marija Gimbutas postule l’existence de tout un panthéon féminin évoluant sous l’égide d’une grande déesse-mère et auquel la société néolithique aurait rendu un culte au sein de tribus matriarcales et matrilinéaires. D’autres chercheurs expliquent que cette même période néolithique a vu apparaître le mythe d’une union sacrée entre une déesse terrienne et un dieu taureau.

Quant aux statues à l’effigie de femmes aux formes souvent outrancières, si on a longtemps pensé qu’il pouvait s’agit d’un culte voué à des déesses nourricières, on considère aujourd’hui, comme l’explique l’archéologue Jean-Paul Demoule, que « leurs traits sexuels exagérés renvoient plus sûrement à une expression du désir masculin sur la femme érotisée qu’à un culte de la fertilité ». Ce qui expliquerait l’insistance des sculpteurs sur les fesses protubérantes, lesquelles ne jouent pourtant aucun rôle dans la maternité. Dans les arts primitifs, en effet, les organes sexuels, sur lesquels se focalise l’attention de l’artiste, sont hypertrophiés aux dépens du reste du corps, très grossièrement évoqué. Et l’archéologue d’ajouter : « Les figures féminines érotisées de la préhistoire signalent plus sûrement la domination masculine qu’un hypothétique matriarcat. » (entretien, L’Obs, hors-série n°102, 27 juin 2019)
« Les mystérieuses effluves émanant du corps féminin… »
Ce qui, en revanche, semble attesté, c’est que cette croyance dans le pouvoir procréateur des femmes a mené les premières sociétés agraires à leur confier la tâche d’ensemencer les champs. « La production agricole reste stérile si elle ne peut être mise entre les mains d’une épouse pour lui faire accomplir le cycle métabolique d’entretien de la vie » explique l’anthropologue Claude Meillassoux dans son livre Femmes, greniers et capitaux (Maspero, 1975, p.121). « Ce sont les mystérieuses effluves émanant du corps féminin qui attirent en ce monde les richesses enfouies aux sources mystérieuses de la vie » écrit Simone de Beauvoir dans Le Deuxième sexe (Gallimard NRF, 1949, tome 1, p.117). Elle explique ainsi cette transition survenue avec la sédentarisation des clans : « Chez les nomades la procréation ne semble guère qu’un accident et les richesses du sol demeurent méconnues ; mais l’agriculteur admire le mystère de la fécondité qui s’épanouit dans les sillons et dans le ventre maternel ; il sait qu’il a été engendré comme le bétail et les récoltes, il veut que son clan engendre d’autres hommes qui le perpétueront en perpétuant la fertilité des champs ; la nature tout entière lui apparaît comme une mère ; la terre est femme et la femme est habitée par les mêmes puissances obscures que la terre. » (p.116) Significativement, il existe chez les anciens peuples agraires un symbole très sexué qui est celui de la charrue labourant la terre-mère.
Or, en sortant du nomadisme et en s’établissant quelque part, les hommes ne se sont pas contentés de planter des céréales, ils se sont aussi mis à élever du bétail. Durant le paléolithique, on est passé d’une économie de chasse à une économie pastorale sous l’effet de l’augmentation démographique et de la raréfaction du gibier. La transformation des chasseurs en bergers, en plus de leur donner davantage de temps pour la réflexion (ce qui a contribué à développer leur intelligence), leur a permis d’observer leurs chèvres. En voyant se reproduire un grand nombre de fois la succession des coïts et des accouchements, ils ont fini par comprendre le lien de causalité existant entre ces deux événements (il était temps !). De cette compréhension du processus reproductif a découlé une prise de conscience du rôle de l’homme dans l’enfantement.

La famille Pierrafeu hésitant à passer le cap de la bipédie
C’est à ce moment-là que la femme, cessant d’être divinisée comme pourvoyeuse unique de la vie, a perdu beaucoup de son prestige symbolique. L’effondrement de ce mythe de la parthénogenèse a entrainé une dévalorisation du rôle maternel et, corrélativement, de la femme elle-même. Le début du patriarcat pourrait trouver là son origine. Olivia Gazalé commente, avec un ton qui n’engage qu’elle : « Désormais, c’est l’homme qui porte la vie, tandis que la femme, assimilée aux puissances souterraines, est naturellement corrélée à la mort. Son ventre évoque les entrailles sombres de la terre – où sont ensevelies les graines, mais aussi les défunts – la matrice ténébreuse du tombeau, le sein cosmique effrayant dont tout provient et qui réabsorbe ses créatures au terme de leur vie, lorsqu’elles sont ensevelies. » (p.56)
« Cro-Magnon était un ignoble phallocrate »
On voit à cette dernière citation que le domaine parfois plus qu’hasardeux des hypothèses relatives à la sexualité de nos ancêtres préhistoriques est un terrain miné par les récupérations idéologiques, qu’elles soient le fait des féministes ou des tenants d’un pouvoir masculin. Charles Fourier peignait dans ses textes l’utopie d’une société primitive qui aurait été fondée sur l’amour libre avant que l’odieuse civilisation (la propriété privée, la monogamie, etc.) soit venue détruire ce bel Eden. Il n’avait vraisemblablement pas vu La Guerre du feu… Toujours dans le camp socialiste, le marxiste allemand August Bebel admettait ouvertement, dans son livre-phare La Femme et le socialisme, qu’il pratiquait sans honte une forme de « révisionnisme » à l’égard des mœurs de la préhistoire dans le but explicitement politique de délégitimer l’argument de l’immobilité cher aux conservateurs – lesquels professaient volontiers qu’il ne fallait pas changer les structures de la famille sous prétexte qu’elles avaient toujours été ce qu’elles sont. Car comme le relevait justement Christine Delphy, le recours à la préhistoire est souvent une forme de naturalisme qui ne dit pas son nom.
« Cro-Magnon, déjà, était un ignoble phallocrate » ironise Natacha Polony dans son essai L’Homme est l’avenir de la femme (JC Lattès, 2008, p.25). Toutefois, certaines féministes elles-mêmes peinent à être convaincues par les bienfaits attendus des réécritures féministes de l’histoire. Camille Froidevaux-Metterie se demande si la thèse de l’antériorité d’une humanité plaçant la femme sur un piédestal (qu’il s’agisse du matriarcat ou du culte matricien) ne pourrait pas être interprétée, du fait justement de son caractère archaïque, comme un stade de développement inférieur qu’il conviendrait de dépasser (par le patriarcat par exemple). Et Claudine Cohen, spécialiste de l’histoire de la paléontologie, se demande dans son livre La Femme des origines (Belin, 2006) : « Cautionner la thèse de la déesse préhistorique, n’est-ce pas pérenniser en la divinisant l’image éternelle de la femme définie par sa passivité et sa fécondité, laissant au héros mâle le privilège de l’individualité et de l’action ? »

Ringo Starr et Barbara Bach dans le grotesque Caveman (1981)
On peut aussi, bien sûr, choisir de laisser les idéologues des deux camps se tirer par les cheveux au fond des cavernes (c’est comme ça qu’avaient lieu les scènes de ménage à l’époque, si j’en crois l’imagerie consacrée) et préférer la rêverie aux querelles archéologiques. L’occasion par exemple de se replonger dans l’âge d’or des prehistoric movies mêlant, au mépris de toute vraisemblance, peuplades néanderthaliennes, mammouths, dinosaures et pêcheuses cro-magnonnes en bikinis de fourrure – à l’instar de l’inoubliable Raquel Welch dans le mythique film One Million Years BC (Don Chaffey, Angleterre, 1966). A voir aussi absolument : le désopilant (ou consternant, c’est selon) Caveman (Carl Gottlieb, USA, 1981) avec Ringo Starr dans un rôle très éloigné de celui qu’il occupait habituellement aux côtés des Beatles. De quoi distraire vos soirées d’hiver !
Mes bonus :
la collection de photos des plus belles femmes préhistoriques du cinéma de série B
Si cet article vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Je poursuivrai cette série sur la culbute à travers le temps. Prochain épisode : va te faire culbuter chez les Grecs.
Vous êtes abonné


