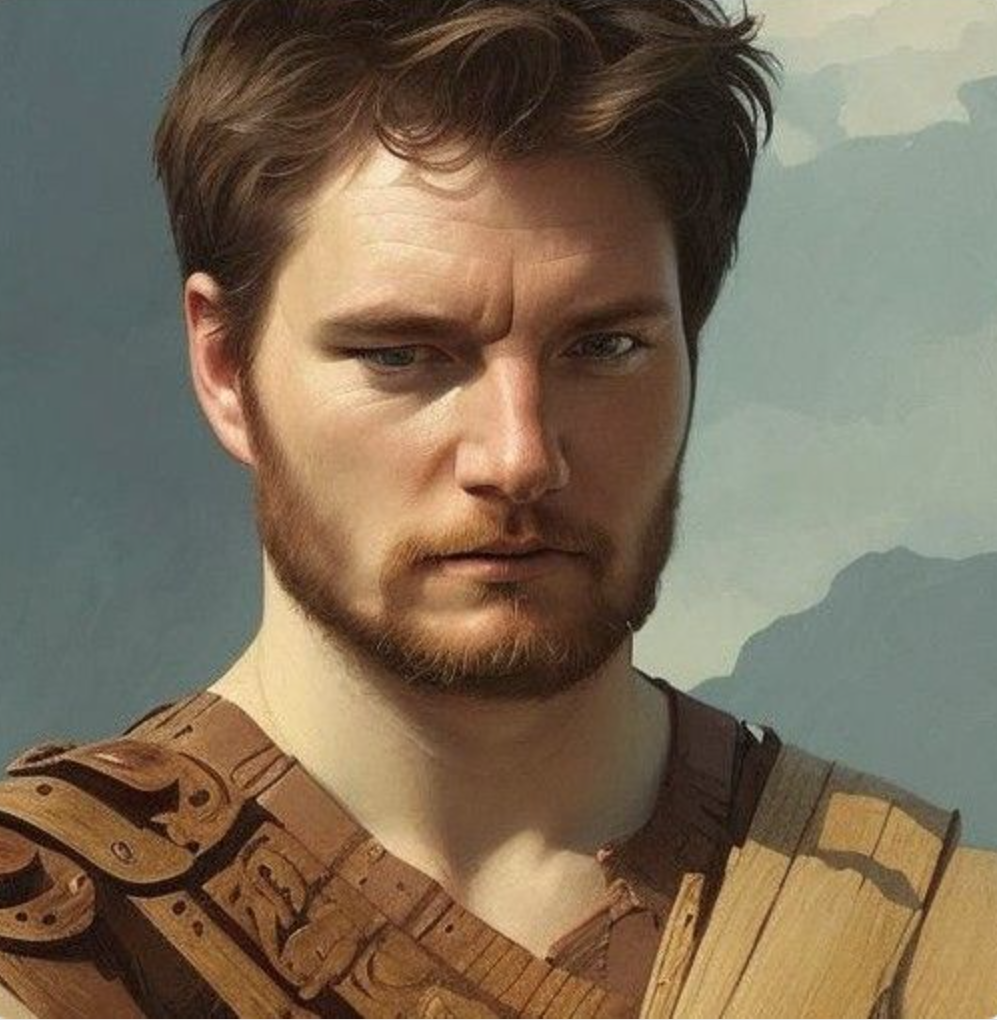
David L'Epée
11 décembre 2023 • 12 minutes de lecture
Alain Lonfat : « J’admire secrètement plus Michael Crichton que Gustave Flaubert »
Alain Lonfat, un vieux compagnon de randonnées et de joyeux banquets que je fréquente depuis plus de vingt ans, a fait paraître l’an passé un recueil de nouvelles, « Contes en clair-obscur ». L’occasion d’un entretien à bâtons rompus.


David L'Epée – Il y a des auteurs qui annoncent toute leur vie avec fracas un grand roman qu'on attend toujours et qui ne viendra sans doute jamais (non, je ne parle pas de moi !). Et il y en a d'autres qui écrivent presque clandestinement, à bas bruit, et qui un jour lancent dans le monde un livre à la surprise générale, parce que personne ne l'attendait et que nul ne les savait écrivains. Tu es vraisemblablement de ceux-là. Quelle mouche t'a donc piqué ?
Alain Lonfat – Tout d’abord, merci pour ton intérêt à l’égard de ce petit livre. Quelle mouche m’a piqué, demandes-tu ? La mouche de la prétention et de la vanité, bien sûr ! Comment sinon prétendre écrire encore de la fiction pertinente dans la pléthore de livres et d’écrivains déjà sur le marché ? N’étant ni reporter, ni témoin de choses extraordinaires, ni l’aboutissement d’un vécu hors du commun, il fallait juste que je me sente digne d’être lu.
J’ai écrit un peu durant mon adolescence et mes études. D’après mes souvenirs, le résultat était mollement mièvre, essentialiste et pas bien passionnant. Peu à peu je me suis dit qu’il était préférable et plus reposant de vivre une vie sans écriture. Vingt ans plus tard, le naturel est revenu au pas de charge, avec l’impression, toute pleine de vanité, que je pouvais écrire des trucs aussi intéressants, finalement, que ce que je lisais parfois dans la littérature contemporaine. Durant ces vingt ans, j’ai eu l’occasion d’accumuler dans ma tête des bribes d’histoires, dont certaines ont perduré jusqu’à aujourd’hui. Des situations, des personnages que je trouvais originaux et assez « fashionables » pour figurer dans une histoire tout à fait lisible et même capable de susciter de l’intérêt et du plaisir. Cela dit, c’est plus la confection de scénarios qui me motive que l’écriture en soi. J’admire secrètement plus Michael Crichton que Gustave Flaubert.
DL – Tu as fait le choix de l'auto-édition. Il y a une raison particulière à ça ?
AL – Il y en a deux (qui sont tout sauf originales) : ces histoires me tournaient en tête depuis plusieurs années, mais une fois la pandémie de covid arrivée, une fois donc que tous les écrivains amateurs comme moi se sont décidés à se lancer, je sentais que je n’avais aucune chance de trouver preneur parmi les éditeurs traditionnels, et j’aurais dû attendre des mois et des mois avant d’avoir des réponses, plus que probablement négatives. Des nouvelles comme celles-ci sont généralement moins faciles à caser que des romans ou des reportages plus compacts. Bref, je l’ai fait par manque d’assurance et aussi par impatience. Oh, et puis il y a même une troisième raison, puisqu’on y est : la conscience du temps qui passe. J’ai eu mon enfance heureuse, mes années d’études, mes années de vadrouille, ma période de famille et de paternité. Et un de ces prochains jours, comme beaucoup, il faudra bien que j’entre dans mes années chimio, mes années d’amertume et de regrets, mes années de préparation au départ et de transmission. Bref, ce sentiment que, quel que soit le résultat, il fallait essayer, là, maintenant, sans attendre le bon vouloir d’un éditeur.

DL – On devine dans ton écriture certaines influences naturalistes. Même si l'étrange, voire le fantastique, interviennent à plusieurs reprises, tes mises en scène s'inscrivent dans une forme de réalisme un peu ruralisant, régionaliste. C'est d'ailleurs souvent, dirait-on, ce qu'on attend des auteurs romands... On retrouve la région fribourgeoise, les coteaux vaudois, ton Valais natal, les alpages... Y a-t-il de ta part la volonté de donner une couleur locale à tes nouvelles ? As-tu eu des modèles (littéraires ou non) en la matière ?
AL – Disons surtout que, même si j’ai aussi séjourné à l’étranger, c’est encore là le monde que je connais le mieux. J’ai mis du temps à aimer nos paysages. Nos montagnes, au pied desquelles j’ai grandi avec la sensation fréquente d’en être gavé, alors que je rêvais d’exotisme (je n’ai pratiquement jamais mis les pieds à l’étranger avant ma majorité civique). Mais aussi nos vieilles gares aux salles d’attente puantes, nos campagnes désertes, nos bistrots emplis des blagues éculées des beaux parleurs du village. La Suisse me semblait vraiment peu sexy et tout sauf littéraire : les grandes intrigues, les romans historiques, l’excitation et l’aventure, tout ça se passait ailleurs, Paris, New York ou Tokyo. Pas dans notre ringard arrière-pays. Et pourtant…
Dans le film American Beauty, il y a une scène présentant un jeune homme dont le plus grand moment d’émotion fut d’observer et filmer un petit sac en plastique virevoltant longuement dans le vent et les feuilles mortes. J’ai un côté contemplatif assez semblable, je crois. Je me suis mis à admirer les reflets du soleil couchant sur les rails rouillés de nos voies ferrées, les mille lumières de nos usines chimiques, le rouge pétant de nos tracteurs au milieu de champs verdoyants, la lueur d’une torche de raffinerie sur les nuages bas… Bref, j’ai résolu mon complexe du provincial et remédié à ma superficialité en prenant un goût assez pictural et un brin nostalgique à ce pays, pas plus beau qu’un autre, mais pas vraiment moins beau non plus, finalement. Quand j’ai recommencé à écrire, je me suis dit que le chemin que j’avais ainsi parcouru pouvait m’être utile pour inscrire des histoires que je voulais captivantes dans ce terroir qui m’avait longtemps paru à mi-chemin entre ridicule et ennuyeux.
Je n’avais pas de volonté de donner une couleur locale, et d’ailleurs ces décors sont typiques, mais pas toujours clairement définis géographiquement. Mais partir de paysages connus et d’éléments concrets, que j’ai connus avec mes sens, me permet d’ancrer mes personnages. C’est, au final, tout un ressenti que j’ai essayé d’utiliser pour créer les ambiances de ces histoires. L’ambiance est une notion qui m’intéresse beaucoup : créer un décor, un sentiment et faire en sorte que le lecteur y entre. Tu parles de naturalisme. Oui, la nature est très présente dans ces contes, mais c’est finalement ce que les personnages (et donc les lectrices et lecteurs) en voient, ce qu’ils ressentent, qui façonne l’ambiance de la scène. Et c’est ce résultat, cette atmosphère, qui m’intéresse, beaucoup plus que la nature ou les paysages (naturels, urbains, industriels ou autres) en eux-mêmes. Et non, je n’ai pas vraiment de modèle assumé sur ce point-là, si ce n’est le principe même du conte.
DL – Un mot sur le fantastique tout de même, car il est omniprésent, dans ses manifestations sinon dans ses apparences. Une forêt hantée, un avatar de loup-garou semant la terreur lors de ses descentes en ville, une jeune fille spectrale confinée dans un grenier, un ogre retranché dans la solitude d'un bois... Parfois il ne s'agit que de faux semblants, de biais de perception, et parfois le mystère demeure et l'hypothèse surnaturelle reste incontestée. D'où te vient ce goût pour ces créatures mythologiques et comment le concilies-tu à ta démarche naturaliste (si le terme te convient) ?
AL – Le concept de ce livre est de proposer des histoires à mi-chemin entre contes et enquêtes. Ou plus précisément des enquêtes, avec une ambiance de conte… ou presque. Pour y parvenir, j’ai volontairement adopté quelques poncifs : ogre, forêt, fantômes, bergers, une porte mystérieuse que personne n’ouvre jamais, etc. Le conte nous fait entrer très rapidement dans un monde fantastique, c’est en ce sens un récit très efficace, où l’on prend rapidement ses repères. Cela peut être des lieux, ou des personnages typiques, que l’on peut décrire assez rapidement puisque les lecteurs s’en font déjà une certaine idée. Je creuse simplement un peu ces éléments, les personnages notamment, pour leur donner une raison d’être, un passé et un sens dans l’histoire, afin de surprendre un peu le lecteur. Mon ogre, par exemple, est grand, pervers, égoïste, mais aussi assez tendre, séducteur et esthète à sa manière. Il renie son passé social et devient solitaire. Il est construit en opposition au personnage de l’archiviste, qui au contraire conserve le passé et s’ouvre au monde. Bref, mes personnages quasi mythologiques, comme tu dis, sont des rouages utiles dans la mécanique du récit.
À partir du moment où, comme dit précédemment, c’est plus l’ambiance dans laquelle entrent les protagonistes qui compte, que le décor en soi, ces personnages plus ou moins monstrueux peuvent avoir toute leur place dans des lieux qui n’ont a priori rien de fantastique (une montagne, une banque, une vigne, un centre-ville, etc.). Décrire ces décors de manière « naturaliste » permet simplement, je trouve, de mieux imprégner le lecteur, peu à peu, de l’ambiance du récit. Ça lui donne à sentir quelque chose qu’il peut facilement se représenter ou se remémorer, pour ensuite le faire dériver vers des sensations plus inattendues.

DL – La notion d’intrigue est très présente dans plusieurs de tes nouvelles, dont certaines ont même un petit côté roman policier. Pourtant tu as choisi de les présenter comme des contes (raison peut-être pour laquelle tu les as dédiés à tes enfants – même si je te recommanderais d’attendre encore un peu avant de leur raconter ces histoires-là !). Qu’est-ce qui, dans tes récits, relève réellement du conte ?
AL – Oui, le côté « enquête » est entièrement voulu et fait partie du principe même du livre. Mais de nombreux éléments relèvent du conte. Il y a, comme je l’ai dit, quelques poncifs. J’ai aussi tâché de choisir un vocabulaire simple et connoté. Les personnages ont plusieurs facettes mais ils sont assez emblématiques et identifiables. Ce qui me semble propre au conte au sens large est aussi la manière d’entrer dans le fantastique, cette sorte d’envoûtement qui annonce le début d’une aventure. Dans les contes traditionnels européens, cela peut être, par exemple, la surprise de voir pousser des haricots magiques jusqu’aux nuages, d’entendre subitement un animal parler, etc. Cela peut aussi être la traversée d’un mur pour arriver sur un quai secret dans une gare londonienne. Mais je crois que les moments d’envoûtement qui m’ont le plus marqué sont ceux des films d’animation d’Hayao Miyazaki, notamment le début du Voyage de Chihiro (l’apparition des premiers fantômes). Et en décrivant un squelette de vache ambulant dans l’un de mes contes, j’avais en tête l’impression que m’ont laissée les sylvains dans la forêt du film Princesse Mononoké. Bien sûr, il y a aussi des contes dénués de fantastique (quoique…) mais l’idée est presque toujours d’entrer dans l’intimité de personnages qui vivent des événements séparés de la marche habituelle du monde. Une sorte de normalité parallèle avec sa logique propre, à découvrir.
DL – Une de nos amies communes, ayant lu ton livre, s'est dit effrayée par le versant un peu sordide de ton imagination. Il y a notamment, dans ta nouvelle Sans un mot, l'exposé d'un crime particulièrement sophistiqué et parfait qui ne déparerait pas dans une nouvelle de Roald Dahl ou dans un feuilleton d'Alfred Hitchcock. Comment un bon père de famille comme toi arrive à échafauder des plans aussi tordus ?
AL – Je pourrais bien sûr répondre qu’en tout bon père de famille sommeille un tueur en série qui ne demande qu’à se réveiller, attisé par l’insupportable bienséance de ses propos quotidien ! Mais ce serait là une réponse très convenue. Permets donc plutôt que je te fasse ici une réponse du type « développement personnel », en te servant deux petites répliques de film (que je cite ici de mémoire, de manière approximative et hors contexte, comme tout bon coach en développement personnel) :
« Je suis ça, ça, ça et encore ça… Je suis un vrai bordel ! » (tiré de L’Auberge espagnole)
« Tu as sans doute du bien et du mal en toi, mais l’important est de toujours choisir le chemin du bien » (tiré d’un Harry Potter, je ne sais plus lequel)
Et voici aussi, pour la route, une citation littéraire maintes fois balisée, de l’éminent Johann Wolfgang von Goethe: « Wir mögen die Welt kennenlernen, wie wir sie wollen, sie wird immer eine Tag und Nachtseite behalten.» (Tu la sens, là, cette énergie en toi qui te pousse à devenir la meilleure version de toi-même ?)
Tout ça pour dire qu’écrire une histoire, c’est aussi être un peu acteur, entrer dans la tête de chacun de ses personnages. Dans cette position, inventer toutes sortes de réactions et choisir la plus sordide ne me semble pas très difficile, on peut toujours faire dans le pire, jusqu’au délire, et un coup d’œil aux faits divers suffit comme source d’inspiration. Dans un registre parallèle, l’humour noir est aussi là pour désamorcer les choses en riant de ses propres défauts moraux, et ce faisant en les exagérant à l’extrême. On peut trouver l’exercice malsain, ou au contraire purificateur, puisqu’à la fin, on prend ses distances avec ses personnages. Question de goût.
En l’occurrence, Sans un mot raconte un crime et peut choquer par ses contrastes, notamment sur l’image qu’on se fait des personnages. Le recueil ne s’intitule pas Contes en clair-obscur pour rien ! Pour me familiariser avec la narration d’enquêtes, j’ai lu quelques romans policiers (ça ne m’était pas arrivé depuis longtemps), histoire de voir jusqu’où on pouvait aller. À cette occasion, j’ai découvert par exemple l’auteur John Connolly, dont les livres, également teintés de fantastique, sont bien plus sophistiqués que mes modestes nouvelles, et beaucoup, beaucoup plus glauques, malsains et sanglants. Mais ni Connolly, ni Hitchcock, toutes effrayantes que puissent être leurs histoires, ne sont de mauvais bougres, ils jouent simplement avec les limites du possible ou de l’imaginable pour divertir le public et lui fournir des émotions par procuration. Je ne fais rien d’autre, à mon modeste niveau. Du reste, Sans un mot n’est pas vraiment réaliste (mais tant mieux si les lecteurs y croient). Il faut aussi et surtout y voir une métaphore du ressentiment qui perdure et moisit par-delà les générations.

DL – Quelles sont tes références littéraires ? Penses-tu que certains auteurs que tu aimes ont pu imprégner l'écriture de ce livre ?
AL – Tu l’auras peut-être compris, je suis un littéraire de pacotille. Je ne lis pas énormément de fiction et je finis rarement les bouquins de plus de 250 pages, je m’essouffle avant. Je ne finirai jamais Dostoïevski ni Proust. Mais ça m’a aussi longtemps préservé de bien des Goncourt et bestsellers. Comme quoi la nature fait parfois bien les choses.
Mes références, comme tu l’auras aussi constaté, sont surtout visuelles et cinématographiques. Les époques ambiguës m’inspirent aussi ; ça vient probablement d’une adolescence baignée de jeux vidéo et de jeux de rôles, où le mélange médiéval-futuriste, par exemple, est fréquent.
Il y a néanmoins des sources d’inspiration littéraires : les contes traditionnels, européens ou suisses, bien sûr, notamment pour la concision de leurs formulations, et les romans policiers, dont je reprends très grossièrement la trame. Il y a peut-être (malgré moi) des résidus de descriptions ramuziennes dans mes décors, ou des relents de Maurice Chappaz, même si, pour les moments de béatitude et de beauté, de nostalgie aussi, c’est plutôt Camus (Noces) et Rudolfo Anaya qui m’ont marqué. Ambiance et nostalgie vont souvent de pair à mes yeux et peuvent provoquer quelque chose d’assez puissant (ce que j’essaie d’évoquer dans ma nouvelle Place des fous). J’ai aussi beaucoup apprécié le célèbre The curious incident of the dog in the night-time, de Mark Haddon, qui décrit génialement le monde d’un point de vue différent, avec des règles propres au personnage principal. Ça reste pour moi un modèle pour décrire et faire comprendre un personnage au lecteur. Quoi d’autre ? J’ai parfois été intrigué par certains vers, concrets, souvent sombres et hallucinés, de Bonnefoy, avec leur rythme bien spécifique ; ça marque peut-être un petit peu mes scènes nocturnes notamment. Et pour l’apparition des petits animaux dans ma nouvelle L’Apprenti, j’avais en tête le bruit des Djinns dans le célèbre poème du même nom. Voilà en gros. Sinon, je ne vois pas trop quoi d’autre citer, mais j’ai sans doute la mémoire courte.
DL – As-tu de nouveaux projets pour la suite ? Un nouveau recueil de nouvelles en perspective ? Un roman peut-être ?
AL – Là, aujourd’hui, j’ai pas mal d’idées en tête, oui. Idéalement, j’aimerais pondre d’abord un recueil de nouvelles plus longues, plus sombres, proches de l’épouvante, et plus oniriques aussi. Deux de ces histoires sont déjà bien avancées. Ensuite, je pense à un (court) roman de politique-fiction parlant principalement de sport. Enfin, œuvre ultime, un livre pour enfant. Un vrai, je veux dire, avec une histoire qui fasse réfléchir les jeunes lectrices et lecteurs, les envoûte, leur donne une petite leçon de vie qui les accompagnera à nouveau dans les moments difficiles de l’existence. C’est un Graal qui me semble totalement inaccessible aujourd’hui, je n’ai pas la sagesse suffisante.
Bref, mes idées partent un peu dans tous les sens et sentent bon la fraîcheur enthousiaste de l’amateurisme. Mais comme pour mes Contes en clair-obscur qui, pour la plupart, ne ressemblent plus trop à ce qu’ils devaient être au début, j’aurai probablement modifié mes ambitions d’ici quelques mois. Pour être plus crédible, disons que mes projets consistent surtout à répartir mon énergie entre mon travail, ma famille, mes amis, un peu de sport et le visionnage de quelques séries télé. Et puis mourir en paix.
Pour commander les Contes en clair-obscur d’Alain Lonfat
Alain Lonfat n’ayant pas voulu me communiquer de photo de lui pour illustrer cet entretien j’ai dû me retrancher sur ces deux portraits réalisés par ses soins via une intelligence artificielle. Au risque de décevoir mes lectrices amatrices d’hommes murs l’honnêteté me pousse à préciser que ces portraits ne sont pas très ressemblants et que l’auteur présente en réalité une allure bien plus jeune.
Vous êtes abonné


