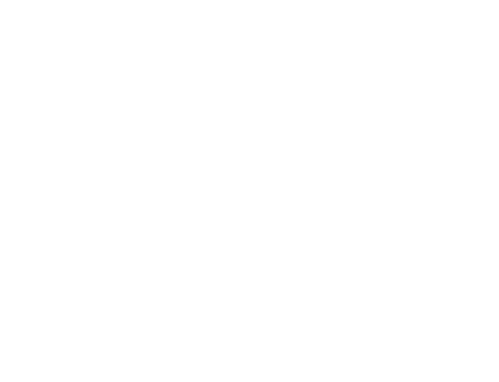
Le Peuple
15 février 2023 • 6 minutes de lecture
« La Chasse au Cerf » par Romain Debluë
Ami et compagnon de route du « Peuple », l'écrivain Benjamin Mercerat nous présente un ambitieux roman au moment de sa sortie en Suisse.

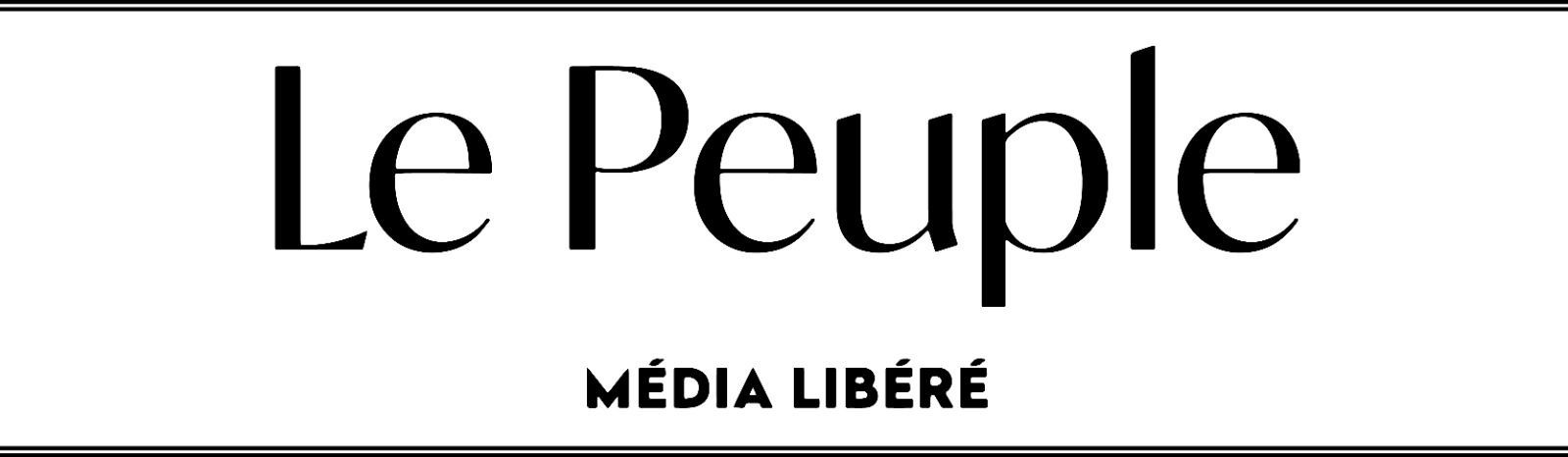
Le Peuple vous apporte un regard à contre-courant sur l’actualité et des sujets de fond directement dans votre boîte email.
Le Peuple est financé uniquement par les lecteurs et opéré à bas coût par des passionnés. Certains articles sont néanmoins payants.
Soutenez "Le Peuple" en vous abonnant dès maintenant via ce lien.
Cliquez-ici pour découvrir nos variantes d'abonnements : gratuit, mensuel ou version papier.*Nota bene : une version gratuite du «Peuple» est également disponible.
Un roman, c’est à l’origine un texte écrit en langue romane. Et il s’agissait, écrivant par exemple en ancien français, dans ce souple octosyllabe de Chrétien de Troyes, de se rendre digne des grands écrivains de l’Antiquité. Le roman, c’est donc à l’origine un texte d’une haute exigence linguistique, à l’image, encore, de la virtuosité néologique et narrative d’un Rabelais. Raconter, penser, digresser, exposer, argumenter ; mais principalement raconter : voilà qui doit être fait en un ton, un style personnels, qui relèvent d’une singularité à la fois dépositaire du génie d’une langue et lui offrant sa propre originalité. Singularité grâce à laquelle est livrée au lecteur non pas un simple scénario mais une vision.
Raconter quoi ? Ce qu’on a vécu, ce qu’on a vu, ce qu’on a ressenti dans ses tréfonds, ce qu’on a lu aussi bien. Cela porté par des personnages, ces être imaginaires auxquels on insuffle une âme par la grâce d’un style. Un grand romancier est à la fois un styliste singulier et un créateur cohérent d’âmes. Pour citer quelques noms plus ou moins récents d’auteurs écrivant en français, c’est-à-dire en roman : Rousseau, Balzac, Hugo, Barbey d’Aurevilly, Bloy, Proust, Ramuz, Bernanos, Céline. Et l’on citera aussi Claudel : n’ayant jamais publié un roman au sens de récit narré avec des personnages, il n’a fait, dans ses pièces théâtrales, que répondre, et de quelle manière ! à la haute exigence définie plus haut.
À ces noms, ajoutons celui de Romain Debluë : trente ans, docteur en philosophie (thèse sur saint Thomas d’Aquin et Hegel à la Sorbonne), Montreusien immigré depuis plusieurs années à Paris ; un genre d’Aimé Pache, pour citer ce personnage d’un des deux romans de formation publiés successivement par Ramuz.
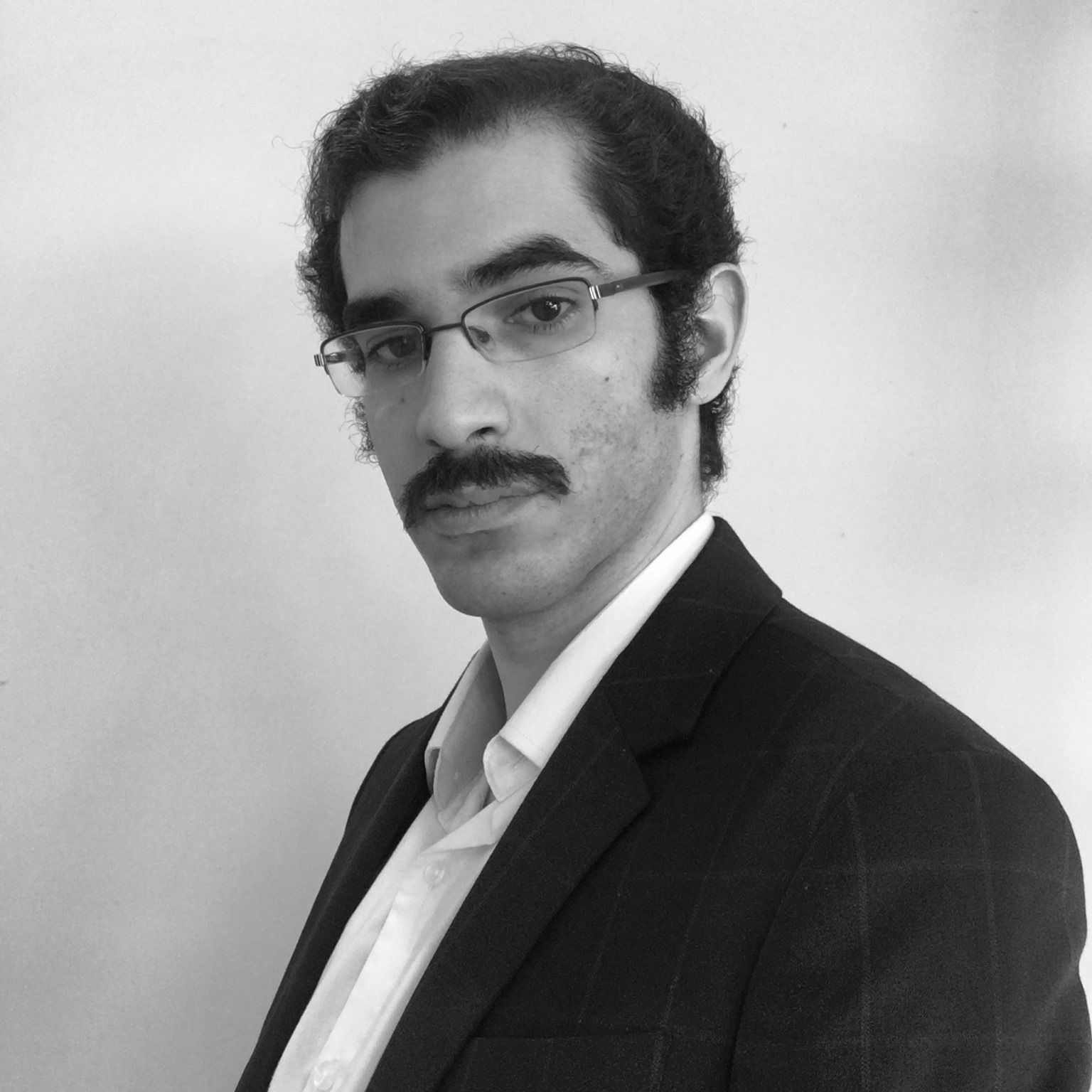
C’est plus à Pache le peintre qu’à l’ouvrier Samuel Belet que fait penser Debluë, qu’on peine à imaginer avec autre chose dans les mains qu’un livre, un stylo, un clavier (d’ordinateur, de piano) ou un violon.
Musique, philosophie, art du roman, théologie, poésie, peinture, voilà les thèmes de prédilection des personnages du deuxième roman de Debluë, dont Les Solitudes profondes (L’Aire, 2016) et leurs quelques centaines de pages impressionnaient déjà par leur habileté – seule œuvre romanesque à prendre sérieusement la succession du travail bernanosien de plongée métaphysique dans les âmes. Ce ne sont pas quelques centaines de pages qui ont satisfait cette fois le souffle du romancier, mais les plus de mille qui constituent La Chasse au Cerf (L’Aire, 2023), roman de formation s’inscrivant dans la tradition romantique, mais dont la tonalité spirituelle est plus proche de Dostoïevski et Bernanos que de Rousseau ou Goethe – sans qu’il faille prendre ces comparaisons trop à la lettre, car il s’agit là d’un art étonnamment mûr, sûr de ses moyens.
Debluë se permet d’aborder les thèmes les plus exposés (la souffrance d’un enfant, la réalité du diable, l’amour humain et ce qu’il a d’éphémère…), et le fait sans cette fausse modestie pleine d’un orgueil insu dont maints contemporains ont le secret : avec un plaisir et une joie immenses, nés de cette même liberté dont naissent l’énorme rire de Rabelais, les aventures à la fois épiques et morales de Chrétien de Troyes, le délire organisé de Dostoïevski, le tragique à la fois angoissé et souriant de Ramuz, l’hallucination maîtrisée de Céline ou encore l’implacable douceur de Proust.
Le personnage principal, Paul Savioz (patronyme dans lequel on entend l’adjectif sauvé), alter ego romanesque de Debluë né comme lui sur les bords du Léman (Saint-Saphorin au lieu de Montreux), monte à Paris pour y étudier l’histoire (au lieu de la philosophie) à la Sorbonne. Ses riches rencontres et ses expériences amoureuses nous sont narrées, Paul Savioz vivant entre Paris et les bords du Léman où il passe ses vacances dans le havre familial ; narration et scènes entrecoupées de discussions philosophiques, théologiques, littéraires ; ici, comme dans un roman de Thomas Mann, tous les personnages sont cultivés et intelligents, sans être tous pourtant les porte-paroles de l’auteur, qui manie la polyphonie romanesque avec habileté, évitant les lourdeurs manichéennes. Le narrateur est d’ailleurs autant à l’aise avec les propos philosophiques qu’avec les descriptions de la nature, le Léman étant en particulier au centre de cet effort pictural plus proche de Proust que de Ramuz, dont l’omniprésence poétique sur nos rivages est ainsi en quelque sorte contournée. Cent ans précisément après la publication de Passage du poète, l’esprit à nouveau souffle sur les rives lémaniques.
En quoi consiste la singularité du génie romanesque debluïen, qui s’exprimait déjà dans son premier opus, mais qui prend toute son ampleur dans La Chasse au Cerf ? La narration, agréablement classique, balzacienne, est tenue par un rythme allant, exprimant certaine solennelle sérénité. Mais rien là de guindé ni de monotone, ce long cours étant ponctué par des scènes (rythme plus lent, temps réel du théâtre) qui consistent en réunions de personnages présentés avant séparément ou se retrouvant à quelque occasion festive ou impromptue. La palette de registres va de la confrontation tragique au festin plein d’humour et de bonne humeur, en passant par la discussion philosophique : on retient notamment, dans la première partie du roman, un échange considérable, par sa longueur comme par sa qualité, portant sur la pensée de Blaise Pascal.
Mais la particularité de l’art romanesque de Debluë, ce sont surtout les moments d’introspection vers lesquels toute l’intrigue semble mener. Temps lent, largo méditatif, plongée dans les profondeurs psycho-spirituelles des personnages, qu’ils soient habités par l’espoir de la résurrection ou, plus souvent, hantés par les affres du péché. Il faut imaginer Dieu rendant visite à l’homme, qu’il prie ou qu’il crie ; il faut imaginer ce qu’il en « apprend », de cette âme qu’il a créée à son image, donc libre : voilà le travail démiurgique et humble à la fois du romancier Debluë, dont le nom succède, au panthéon romand, à ceux de Rousseau, Ramuz, ou encore Mercanton.
Œuvre qu’on ne saurait cependant trop attacher à une région, bien qu’on sente que l’auteur ne saurait habiter loin d’elle trop longtemps… Ne serait-ce pas, comme dans le cas d’Aimé Pache, en retrouvant son pays natal que Paul Savioz devient celui qu’il est, c’est-à-dire connaît pleinement la grâce du Salut ?
Benjamin Mercerat
4e de couverture:
Paul Savioz est un jeune homme qui s’ennuie sur ses rives natales du Léman. En quête d’incandescence et d’aventures intérieures, il s’en va terminer ses études à Paris. Il y découvre et le ciel et l’enfer, mais tarde à comprendre qu’il lui faudra une fois choisir, pour sa perte ou son salut, entre ces deux royaumes. Beaucoup de temps et beaucoup de rencontres lui seront nécessaires pour se souvenir de ceci, que la vie humaine a peut-être un sens, et qu’il n’est pas dans la nature de l’homme de se contenter du monde ni du temps.
Justin, d’abord, le compagnon d’errances, étudiant en philosophie, l’ami, le frère ; Guillaume, ensuite, l’excentrique catholique tout imprégné de réminiscences du Grand Siècle ; et les femmes, bien sûr : Françoise, d’abord, la flamboyante Françoise, mystique ou bigote, scin- tillante dans le ciel comme la vie parisienne sur la terre ; et puis Émilie, non plus à Paris mais de nouveau en Suisse, douce, pensive et sombre, qui ne croit plus à rien mais s’en désespère. D’égaré, Paul Savioz deviendra guide alors, digne ou indigne, de celle dont il aimerait qu’elle le rejoignît sans que lui-même se perdît dans cette nuit où il l’entrevoit, passante éperdue de l’ombre.
Mais n’est-il pas présomptueux d’espérer sauver quiconque ? L’amour des hommes suffit-il à rendre l’espérance ? Si La Chasse au Cerf est un roman d’amour, c’est d’un amour absolu. Car le roman a pour tâche essentielle de rappeler à l’homme qu’il n’est pas de fuite possible ni devant l’infini de son âme, ni devant l’éternité de ses destinées.
Bibliographie de Romain Debluë:
Les Métamorphoses de Protée, recueil d’articles, Via Romana, 2013
Les Solitudes profondes, roman, L’Aire, 2016
Hegel ou le festin de Saturne, essai, Beauchesne, 2019
La Chasse au Cerf, roman, L’Aire, 2023
Vous êtes abonné


